TAKIYA ! TOKAYA !
1991 |
La pièce, qui tire son tître de deux des vingt-neuf mots proposés par Joyce dans « Finnegans Wake » pour signifier « Paix! », a été commandée en 1989 à Enzo Cormann par le metteur en scène Alain Françon, alors directeur du Centre National Dramatique de Lyon.
Fable chaotique et furibarde, façon d’ars moriendi à l’usage des mécréants, TAKIYA! TOKAYA! évoque l’histoire d’un roman qui n’en finit jamais de commencer et que clot pour toujours la mort programmée de son auteur.
Méditation rêveuse sur les rapports subjectifs qu’entretiennent la mort et le travail littéraire, (ma propre relation à la mort, et la mort à l’oeuvre dans mon écriture) la pièce est construite autour du personnage de Mademoiselle, écrivain, hémiplégique, au terme d’une existence qu’on devine bien remplie.
Cette ultime fiction, fragmentaire, (“vagabondage pensif” dit Mademoiselle) se peuple peu à peu de personnages décalqués d’elle-même ou de son rare entourage : le docteur Citron qui la soigne inspire le personnage de Pépin. Le nom de sa nouvelle secrétaire (Bollane) fournit celui du personnage central (Mc Bollan), portrait en négatif de son fils adoptif, etc…
De ce fait, les quelques vingt personnages qui traversent la pièce, au fils des cinq fictions principales qui la composent sont interprêtés par les cinq mêmes acteurs incarnant l’auteur ou ses proches : Mademoiselle, sa nouvelle secrétaire, son fils adoptif, le fils de ce dernier, son médecin.
Entre chaque épisode d’écriture, Mademoiselle et Lila, sa secrétaire, échangent sur la progression du travail en cours, tandis que la mort gagne tant au plan littéraire que personnel.
Peu à peu, Lila, en charge à sa manière des derniers jours de Mademoiselle, prend le relai pour mener l’ouvrage à son terme.
La littérature et la mort sont cannibales. Sur le mode du cannibalisme stellaire, Mademoiselle, véritable trou noir de la pièce, engloutit les êtres passant à sa portée, pour les agglomérer au chaos pressenti de la mort. Le désir qui préside à la création littéraire est chez elle moins celui de laisser une trace (fantasme d’éternisation) que de se dissoudre dans l’humanité (fantasme d’universalisation). Mourir n’est pour elle pas tant finir que céder enfin à l’appel lancinant du chaos auquel résiste justement le travail littéraire, en ce qu’il est effort d’ordonnancement, tentative pathétique de faire sens dans l’hypercomplexe embrouillamini du monde.
“Comme c’est étrange, fait dire Virginia Woolf à l’un de ses personnages, la façon dont les morts se jettent sur nous au coin des rues, ou dans les rêves !” A tout bout de champ. Les morts ne nous accompagnent pas tant qu’ils nous habitent. Nous cherchons un mot, nous trouvons un visage. Nous nous interrogeons, une oeuvre nous répond. Les morts nous parlent, non qu’ils s’adressent à nous, mais ils se disent en nous, ils ne laissent aucun vide, ils ne nous manquent pas : nous en sommes envahis.
Charles Juliet rapporte ce propos du peintre Abraham Van Velde : “Nous sommes toujours deux. Un vivant et un mort. Et ils sont constamment aux prises.” On pourrait presque dire : chacun de nous est innombrable. D’innombrables vivants et d’innombrables morts. Et qui sont constamment aux prises. Je n’ai jamais pu me déprendre de l’idée que le théâtre n’est au fond qu’une entreprise de publication de ces voix mortes dont tout un chacun est criblé. De réincarnation.
La fascination de nombre d’écrivains, fussent-ils rigoureusement athées, pour les anges, me semble l’expression d’une reconnaissance de ces voix plus intériorisées qu’intérieures, de ce capharnaüm de voix qui compose pour une part la subjectivité de l’écrivain. L’invention théâtrale dote les anges de masques, mixe les voix, brouille les cartes. Nul n’écrit sans doute sous la dictée, mais chaque phrase écrite éveille un mort, et la phrase suivante est déjà comme une prise de notes sur la figure qui la hante.
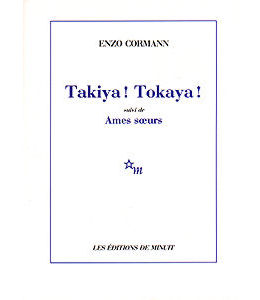
Radio : Enregistré et diffusé en direct et en public, studio Charles Trenet, Maison de Radio France, le 24 février 1996.
Mise en ondes, Claude Guerre.
Traduction(s) : Heinz SCHWARZINGER | allemand
FERNANDO GOMEZ GRANDE (esp.) | espagnol (castillan) – publiée aux editions Escena, Madrid, 1998
Paola CICOLELLA | italien
