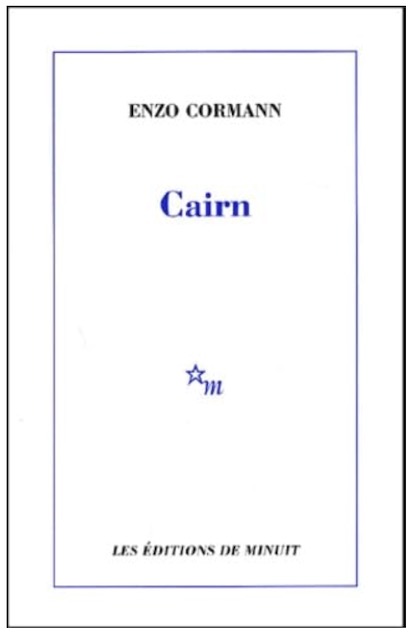CAIRN
2003 |
Jonas Cairn, délégué du personnel dans l’entreprise de poêles et cuisinières Dieudans, se bat contre la vente de l’usine et la suppression d’un millier d’emplois…
"Une pièce fin de siècle" - article de Jean-Loup Rivière (extrait)
Cairn est le héros de Cairn, et il porte ce nom de « cairn » qui désigne un tumulus, un tas de pierres que les voyageurs et les explorateurs dressent comme trace de leur passage, comme point de repère. Cairn est à l’école primaire quand son père est tué en Algérie pendant la guerre d’indépendance; il est, trente-sept ans plus tard, leader syndical dans une usine de poêles et de cuisinières à l’heure de la « mondialisation « . La pièce est l’histoire du destin de ce héros rebelle. Quel est ordinairement le destin d’un « rebelle » ? Révolutionnaire, poète ou homme de pouvoir. Cairn raconte l’histoire d’une rébellion qui ne se convertit en aucune de ces trois figures. Et c’est ainsi qu’elle pose des petits tas de pierres dans le siècle écoulé.
C’est une pièce qui n’aura peut-être pas de » chance » : elle tombe mal. Parlant de notre temps, elle est intempestive. Contre le » tableau » — voyez ces personnages habilement croqués, ces situations cocasses ou terribles —, elle fait le pari de l’épopée : suivez ce mouvement, comprenez ces transformations, butez sur ces contradictions… Les petites histoires domestiques, les petites subversions convenues, les petites perversions à la mode, les petites descriptions sans conséquences, les petites dérives pittoresques abondent dans la dramaturgie (théatre et cinéma) contemporaine; Cairn tranche en faisant tomber les murs pour que le « monde » soit sujet de son histoire…
Le deuxième intérêt de cette pièce — et ces deux-la suffiront — est son style : c’est une pièce qui » exagère « . Elle tranche avec le bon ton à l’ancienne dont les régurgitations se font rare, et avec le bon ton progressiste qui domine. Oui, elle n’a pas de » chance « … En quoi exagère-t-elle ? En ce qu’elle rompt avec le réalisme et l’allégorie. Elle ne reproduit pas la réalité, elle la grime, et elle refuse l’abstraction du symbole. Avec l’histoire que Cairn raconte, on pourrait faire un téléfilm, c’est-a-dire la réduire à la banalité homogène de nos représentations, mais elle reste » indigeste » grâce a son style. Quel est-il ? En deux mots : grotesque et poésie, sachant que « grotesque » n’est pas bouffonnerie complice, et « poésie », charme du crépuscule. Grotesque et poésie, ce qui nous manque…
( » Les Cahiers du Théâtre « , Revue trimestrielle de la Comédie Française, n°36, Été 2000.)
Entretien
Genèse de Cairn
Denys Laboutière : Quelle place occupe ce texte dans votre œuvre d’écrivain ?
Enzo Cormann : Pour écrire Cairn, je suis allé voir du côté de l’usine, de la production industrielle. J’ai pensé à des gens qui se battent en tant que délégués syndicaux. J’ai pensé aux difficultés qu’ils rencontrent, au mépris dont ils sont fréquemment l’objet.
(…)
Cairn est l’histoire d’un anti-héros absolu. J’ai commencé à écrire la pièce en 1996. On sentait déjà bien alors les effets du désintérêt croissant pour l’action collective, du désengagement postmoderne, avec ses inquiétantes répercussions politiques.
(…)
Il paraît que nous vivons désormais dans une société sans classe ! Ah oui ? (rires). Malheureusement, quand j’ouvre le journal, je peux constater en un coup d’œil que les conflits sociaux n’ont baissé ni en nombre ni en intensité. Des entreprises ferment, les gens occupent des usines, créent des comités de lutte, les CRS balancent des grenades lacrymogènes et des coups de matraque, des milliers de personnes sont licenciées, et des enquêtes récentes montrent une inquiétante augmentation du nombre de suicides liés à ce type de situations.
(…)
Les mots censément « raisonnables » utilisés quotidiennement par les gourous de la religion financière, tous les sermons du néo-libéralisme, tuent et désespèrent. Des centaines de milliers de précaires, de smicards, de chômeurs… sont tout simplement malheureux, et souffrent concrètement, désespérément, dans nos paradis pragmatiques. Il n’y a plus d’utopie, plus aucun idéal de solidarité, de partage. C’est le prix à payer pour l’abandon des « grands récits » de légitimation. Par quoi les idéaux égalitaires sont-ils remplacés ? Par l’ironie ?
L’assemblée théâtrale a pour fonction de réexaminer le présent et l’avenir de l’espèce, sans présupposé idéologique, et par les moyens qui lui sont propres : la fiction, la poésie, le jeu.
Si l’assemblée théâtrale a un sens, elle doit notamment s’interroger sur ces fluctuations de notre rapport au politique. Elle doit réfléchir aux relations tumultueuses qu’entretiennent l’intime et le politique. J’aspire à un théâtre qui s’émanciperait des deux modèles dominant de la modernité : drame (Tchekhov) et épique (Brecht). J’appartiens à une génération d’écrivains dramaturges qui n’ont pas cessé de travailler à ce dépassement.
Chacun apporte son petit caillou
D.L. : Avec Cairn, vous interrogez aussi la place du Poète, au sein de la cité.
E.C. : Dans une de mes pièces, Diktat, il y a un passage auquel je suis très attaché : au beau milieu de l’action, l’un des deux antagonistes se tourne vers la salle, vers l’assistance et déclare : « Voici venu le moment attendu, où le vivant qui s’exprime par ma bouche, ne sait plus dire sa vérité sur cette guerre, sa vérité d’homme seul et sa vérité de citoyen et sa vérité de père et sa vérité d’amant et sa vérité artistique et politique et morale et cognitive et compassionnelle, parce que les vérités sont innombrables et contradictoires et que nul ne s’explique en vérité par la bouche des morts sans mentir. »
Le poète est « mouvementeur », pour reprendre un terme cher au peintre Jean Dubuffet — ni savant, ni professeur, ni devin, ni prophète. Je pense souvent au tableau fameux de Rembrandt « La Leçon d’anatomie ». On y voit l’anatomiste Nicolaas Tulp disséquer un cadavre, en présence de nombreux médecins. Le jeu des regards est fascinant (les psychanalystes s’y sont beaucoup intéressés — pour d’autres raisons, sans doute, que les miennes).
Pour en rester au statut du poète, notons seulement que les « spectateurs » de cette séance de dissection considèrent d’évidence Nicolaas Tulp comme le mieux à même de procéder à l’examen du cadavre, mais pour autant nul ne paraît le regarder comme quelqu’un qui possèderait un savoir supérieur de la vie et de la mort, — en clair : de la condition humaine. Le poète dramatique n’est que l’artisan d’un retour sur soi de l’assemblée des hommes. La tâche est déjà bien assez lourde pour ne pas y ajouter de quelconques prétentions à la sagesse et au savoir !
(…)
D.L. : Cairn est-il un texte qui proposerait une réponse au vers de Hölderlin « pourquoi des poètes ? »
E.C. : En un sens, oui. Cairn dit « si j’étais poète, je réveillerais le langage ». Lorsqu’on nous annonce, lors du journal télévisé de 20h, que « de violents affrontements se sont produits » entre la police et les ouvriers qui occupent une usine, l’adjectif « violents », le substantif « affrontements » sont vidés de tout sens. C’est du langage figé, mort. Du stéréotype, qui n’embraye plus sur aucune pensée, aucun « transport ». Cairn, donc, dit : « Si j’étais poète, je saurais rendre les mots réels, et je vous les dirais. » A cet instant précis, il est mon scrupuleux porte-parole.
Mais, pour « réveiller le langage », il faut quand même se lever de très bonne heure ! (rires). Raconter une histoire, écrire une pièce, c’est parvenir à ramener la vie, dans toutes ses composantes, à un nombre extrêmement réduit de variables. On ne peut pas résumer Cairn en deux phrases, pour la bonne raison que rien de ce qui fait notre existence, personnelle et collective, ne peut tenir en une paire de « sujet-verbe-complément » (à moins que l’on tienne pour pertinent le synopsis suivant : « Il vit un peu. Puis il meurt. »).
D.L. : Cairn rencontre Kerouac dans votre pièce. Mais il est surtout, me semble-t-il, un frère possible de Rimbaud ?
E.C. : Dans une note de 1997, j’ai retrouvé la phrase suivante : « Cairn a rêvé de devenir Rimbaud, puis il est devenu le facteur anonyme ».
Mais parlons plutôt de Kerouac. Quand j’ai commencé à travailler sur la pièce, j’avais plus ou moins l’idée que la pièce se jouerait vers l’année 2000, lorsque j’aurais 47 ans (l’âge de Cairn dans la pièce). Or Kerouac est mort précisément à 47 ans. Il y a un effet de trio entre Kerouac, Cairn et « moi ».
Kerouac était alcoolique, déchiré entre un « idéal du Moi » inaccessible, nourri de bouddhisme, et par conséquent de détachement, et de contemplation, et un Moi sordide d’ivrogne, incapable de s’arracher aux affres de l’autodestruction, et promis à devenir une loque.
Lorsqu’il lui apparaît en rêve (ou dans son coma), Kerouac conseille à Cairn de se détacher des contingences et de jouir du monde tel qu’il est. Bien sûr, Cairn en tient pour l’attitude opposée : il veut à tout prix changer le monde. Les dés du face-à-face sont pipés : Kerouac ne sait que trop qu’il est impossible de jouir du monde en l’état. De son côté, Cairn a déjà compris que nul ne pouvait prétendre à changer l’ordre prétendument naturel des choses… Je dirais simplement que ce face-à-face entre le poète et le desperado (mais aussi, entre le désir de suicide et le désir de révolution) pourrait me tenir lieu d’autoportrait. (…)
Le rebelle et le politique
Au fond, je n’ai trouvé ma « voie » (et ma « voix » !) qu’en agitant toutes ces questions, dans des pièces où les personnages sont eux-mêmes agités par toutes les contradictions de l’espèce. A commencer par celle-ci, formulée par Edward Bond : « comment être humain, dans une société inhumaine ? »
Je mène une vie qui, vue de l’extérieur, pourra paraître « rangée », voire « petite bourgeoise ». Mais, l’écriture exige que tu lui consacres l’essentiel de ton temps. Kerouac, le « vagabond solitaire », n’a dans les faits que très peu voyagé. Pour l’essentiel, il a vécu sa courte vie auprès de sa mère, et a passé la plupart de ses soirées à se soûler dans les bars en compagnie de gens qu’il méprisait, et qui le méprisaient, et qui n’étaient pas fichus de le lire… Mais il fut quand même un voyageur d’exception, en ce sens qu’il prit, comme il l’explique lui-même, « l’Amérique comme poème, au lieu de l’Amérique comme endroit où se débattre et suer ».
Création Les Célestins de Lyon – 13 mai – 8 juin 2003
Mise en scène, Claudia Stavisky
Scénographie, Rudy Sabounghi
Lumière, Marie Nicolas
avec, par ordre alphabétique :
Philippe Faure, Marie-Sophie Ferdane, Pierre Louis-Calixte, Caroline Proust, Christophe Reymond, Alain Rimoux, Richard Sammut, Christian Taponard, Martine Vandeville.
FRANCE CULTURE : enregistrement en public lors du Festival « Mousson d’été 2002 » à Pont-à-Mousson. Mise en ondes Claude Guerre. 1ère diffusion 3 septembre 2002.
Traductions :
Heinz SCHWARZINGER
allemand
Lui écrire
FERNANDO GOMEZ GRANDE (esp.)
espagnol (castillan) -Editions « Astillero », Madrid, 2005
Lui écrire
Ella WILDRIDGE
anglais
Lui écrire